06 - Dépasser les empirismes
Dépasser les empirismes et héritages dont l'usage nous est fastidieux
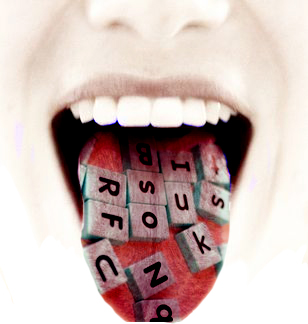
Nous persistons à rejeter en bloc la possibilité d'intégrer ces nouvelles manières d'écrire. Sans considération de la dimension créative que révèle la première démarche, qui consiste à s'approprier l'orthographe en y intégrant des modifications essentiellement visuelles ou comportant des jeux typographiques.
Quant au second cas qui consiste à ne point trop s'inquiéter des règles d'orthographe et de les malmener par facilité : il est modernisme. Il impose le dépassement des empirismes et héritages dont l'usage nous est fastidieux et inutile ; quand nous ne méconnaissont pas la source d'un usage orthographique construit sur un empirisme, celui-ci devient impropre à traduire notre quotidien et difficilement assimilable. Un nouvel usage se fait jour dans cet abandon des normes anciennes. La langue reste bel et bien dans un emploi parfaitement nouveau qui traduit ce que la jeunesse insuffle à nos médias ; la langue doit être belle dans ce qu'elle dit et dans la manière dont elle le dit, mais aussi dans son expression graphique, du jeu typographique au graffiti, du street art au pochoirs...
Les pesanteurs d'une écriture ne sont pas des pesanteurs dans l'écriture mais dans la vie de celui qui écrit : c'est toujours quand la vie est entravée que la langue trébuche.
L'Eloignement du monde, Christian Bobin
Car c'est bien l'usage, et non la grammaire, qui fixe les règles de la langue, au parler comme à l'écrit. C'est en tout cas le point de vue de Ramus, pour qui les grammairiens n'ont aucune autorité sur la langue ; ils doivent se contenter de l'enregistrer, et avant lui de Robert Estienne, pour qui c'est en premier lieu l'usage, par la suite épuré par la grammaire et la dialectique, qui préside à la construction du langage. Le grammairien, le dialecticiens, observent la pratique de la langue pour en dégager les formes constantes qui lient les membres d'une même communauté linguistique ; il ne fait pas autorité sur la forme que prend notre langage, mais transcrit les éléments qui finissent par dégager l'usage consacré. Il n'est pas autorité, l'autorité est la pratique. Il est clerc, notaire de notre pratique du langage.
"Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire arrivent aisément", Nicolas Boileau
Pour Malherbe, l'usage commun de la langue, dès lors qu'elle est pratiquée comme langue native ou maternelle, s'érige naturellement selon des règles logique, et l'oral et l'écrit doivent parfaitement se répondre. Un posteriori qui éloigne toute possibilité d'une langue écrite hautement littéraire et poétique qui viendrait comme pendant de langue orale d'un caractère exclusivement usuel : l'oral et l'écrit doivent coïncider.
"En démystifiant (et en ridiculisant) l'autonomie des poètes par rapport à l'usage, Malherbe affirme la supériorité linguistique comme la maîtrise des règles qui préexistent à l'individu. La norme doit s'imposer à tous, elle n'est pas située a priori dans l'espace social, mais elle exige toute une adhésion au consensus social. C'est notamment à partir du sommet de la hiérarchie sociale que la normalisation doit s'accomplir (...) Malherbe condamne le registre populaire, auquel il associe le vocabulaire du corps, jugé "bas" et "sale", tandis que le registre de l'esprit est davantage celui de l'usage des nobles (...) C''est dans ce climat que Richelieu fonda l'Académie française, en utilisant les ressources d'un cercle littéraire qui se réunissait autour de Valentin Conrart ", écrit Bernadette Wynants dans L'Orthographe, une norme sociale.
Or le "nettoyage" de la langue entrepris dès lors certes vient l'harmoniser, mais aussi la dépouille de ses terminologies et spécifités propres à des communautés ou des groupes identitaires visés par une certaine censure. Dès lors qu'elle s'appuie à "fixer" les règles de l'usage commun, la grammaire exclue tous les usages particuliers et spécifiques: elle expurge.
Pour Vaugelas, si les normes du langage sont déterminées par l'usage public, encore l'usage public n'est-t-il pas l'usage commun, ou l'usage par le plus grand nombre, mais le Bon Usage, autrement dit l'usage par l'élite, et non l'usage par les classes populaires. Le Bon Usage est alors défini par la cour, tandis que le langage reflète la personne "sociale", indique sa position ; la rupture entre l'élite et le peuple est consommée.















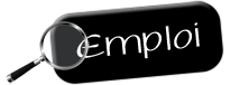













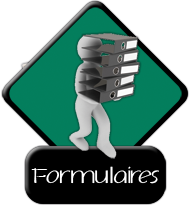










Ajouter un commentaire