10 - Norme sociale
 L'orthographe comme norme sociale
L'orthographe comme norme sociale
Il est intéressant de lire, à ce propos, l'ouvrage de Bernadette Wynants : L'Orthographe, une norme sociale, intégralement consultable en ligne. "La langue est un instrument à partir duquel les hommes communiquent entre eux. Elle est directement liée à l'activité productrice et par là, c'est un instrument neutre." L'orthographe évolue donc selon de multiples facteurs culturels et sociaux.
"L'orthographe, qui n'était encore au XVIIIe siècle qu'un art d'écrire, une esthétique du choix entre divers usages, s'est institutionnalisée dans un processus long et complexe qui trouve son aboutissement dans la pédagogie de la langue telle qu'elle fut pratiquée par l'école du XIXe siècle" (où le recours à l'écriture concerne encore une minorité). "Pour saisir le processus d'institutionnalisation de l'orthographe, sa fixation, son extension dans l'espace et le temps et la construction de cette norme dans l'usage linguisitique, il faut comprendre ses affinités avec trois phénomènes profondément imbriqués entre eux et qui participent à la construction de ce que l'on désigne généralement sous le terme de modernité : la logique de l'écriture et le processus de scripturalisation du monde, qui créent un horizon de langue per se, objectivable, susceptible d'être façonnée par des normes abstraites ; l'affirmation du principe de statut conquis (et l'affaiblissement du statut prescrit) dans les pratiques d'évaluation sociale, par valorisation de l'effort, du mérite, de la quête de conformité dans les théories du Bon Usage ; et enfin un processus d'affirmation nationale en France, qui dès les toutes premières attextations du français, se construit en créant une langue nationale que les révolutionnaires, de 1789 à 1794, associeront étroitement à une définition de la démocratie."















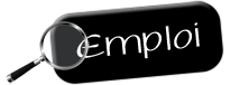













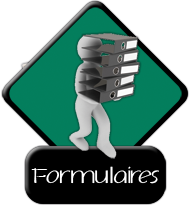










Ajouter un commentaire