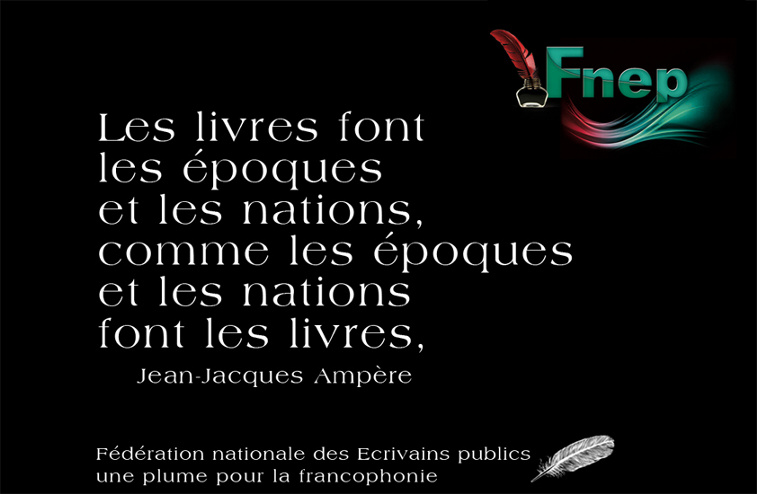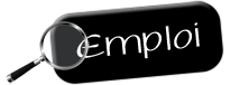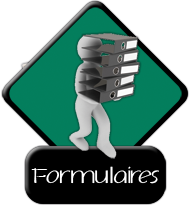L'écrivain public
et la langue française
S'il est le transcripteur d'un mode d'expression à un autre - de l'oral à l'écrit, l'écrivain public n'est pas pour autant prescripteur du bon langage ou de la bonne grammaire. Il sait l'utiliser, il fait usage et démonstration de la grammaire et de la langue dans ce qu'elles ont d'utile aux échanges courants et administratifs, mais ne fait pas la promotion d'une manière d'écrire qui serait plus "appropriée" qu'une autre. Autrement dit, il ne porte pas aux nues les moyens mis à la disposition du propos aux dépens du propos lui-même. En aucun cas l'écrivain public n'invite l'usager à le suivre dans un engagement en faveur de la langue ou de la bonne manière de la pratiquer ; l'usager ne suit pas l'écrivain public dans son expression, c'est l'écrivain public qui le suit.
Dans leur relation, c'est bien l'écrivain public qui est au service de l'usager et non l'inverse, aussi périlleux que lui paraisse le chemin sémantique et dialectique sur lequel il est entraîné. Parce que la langue, la manière que l'on a de la parler, de l'écrire, est multiforme et autant porteuse d'expression dans l'une ou l'autre de ses incarnations, aussi peu châtiée puisse-t-elle être.
L'écrivain public en suit les évolutions quotidiennes, les confronte les unes avec les autres. De l'écriture courante à l'écriture littéraire, de l'écriture commerciale à l'écriture administrative, et plus que tout, du langage parlé et de ses nouvelles expressions à sa transcription écrite, il observe. Il faut compter en outre sur le caractère éminemment vivace de la langue, qui la fait évoluer sans cesse. Dès lors, toute vocation de figer le français dans un enseignement qui porterait sur des règles en perpétuel porte-à-faux face à l'usage courant serait ô combien prétentieux, et par essence d'une complète absurdité. S'il anime des ateliers d'écriture, il ne s'agit en aucun cas de fustiger qui ne maîtriserait pas les méandres de la bonne grammaire, de la syntaxe appropriée, et d'invalider ainsi l'emploi précédent que son usager ferait du français ; le français n'est jamais mal employé dès lors qu'il est intelligible et propre à transcrire la plupart des nuances du ressenti.
Refuser le rôle de prescripteur au profit de celui de transcripteur
L'écrivain public est porteur de communication, sous toutes ses formes. Il ne bannit pas le langage SMS, qu'il a appris à "interpréter", à transposer dans la forme de la correspondance traditionnelle.
Parce que lorsque l'un de ses usagers lui adresse l'un de ces fameux messages électroniques, pour lui demander d'ajouter à son courrier "1 mo kom koi G tjrs pa trouvé de taf mé k G kiffé la formation", il ne manquera pas de comprendre que Monsieur Untel, qui est venu le voir il y a trois jours pour une lettre de demande d'entretien avec sa conseillère pour l'emploi, souhaite ajouter un paragraphe à son courrier pour préciser qu'il n'a toujours pas trouvé de travail mais reste mobilisé par ses différentes recherches, et qu'il a participé à une formation qui lui a semblé très profitable et intéressante ! A l'instar du vêtement, les langages ont leurs modes ! Un mot d'argot fait son apparition parmi les jeunes de tel quartier pour disparaître un an plus tard.
Un autre lui a déjà succédé !
|
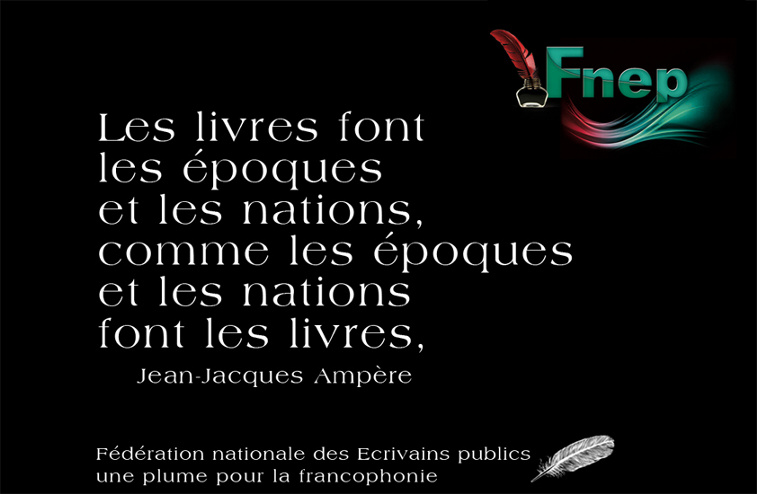
Des termes que l'on emploie depuis la nuit des temps disparaissent, faute de ne plus correspondre à une certaine réalité. Ils font désormais partie de la littérature "muséale", celle des dictionnaires et des manuels.
Je n'ai jamais entendu aucune personne de moins de trente ans, issue des quartiers populaires, employer l'adjectif "alambiqué" ; c'est que nous ne sommes plus au temps des alambiques, et en tout cas bien loin de la campagne. Ici, pour boire un coup, on va plutôt voir Momo, dont l'épicerie fait toujours "krom". On ne va pas non plus chez le chapelier, l'on préfère surfer à la recherche des baskets "collector", de tirage limité, qu'on ne trouvera que sur le site étranger d'une marque-multinationale, cependant que l'on "twitte" beaucoup. L'on envoie désormais des émoticônes comme l'on donnait avant l'accolade et le smiley est en passe de devenir l'interjection la plus répandue.
L'âme humaine, avide d'expressions dans lesquelles elle pourra s'épanouir, ne saurait se figer dans un langage dont la forme serait aussi immuable que la pierre.
Résoudre la question du décalage
entre le français parlé et écrit
L'écrivain public n'est pas seulement médiateur en ce sens qu'il met les souhaits de l'usager en regard des possibilités administratives et sociales correspondantes, il est médiateur du propos oral vers sa forme écrite, forcément inscrite dans un décalage qu'il s'efforce au maximum de réduire : si ni les mots ni la forme ne sont tout à fait les mêmes, le sens doit être scrupuleusement respecté.
S'il anime un atelier consacré, par exemple, à la rédaction administrative, ou au vocabulaire, il ne viendra en aucun cas porter ombrage aux manières de parler et d'écrire déjà acquises par le participant. Aucune forme du langage n'a préséance sur une autre, aucune n'est plus juste que celle qui est la plus chère à celui qui s'exprime ; toutes les manières d'écrire et de parler sont bonnes, toutes sont viables dès lors qu'elles sont porteuses de sens, et tout acte de communication, même le plus anodin, est par essence porteur de sens profond.
Je vois personnellement plus de chaleur spontanée dans l'expression malaisée mais sincère de la personne, que dans celle, certes impeccable, mais profondément rigide, du grammairien qui s'offusquerait du traitement courant que l'on réserve à la grammaire ; il ferait preuve d'un défaut de curiosité difficilement excusable. Le langage du premier, quelle qu'en soit la facture, m'est plus agréable que tout autre. Je suis en outre avide du devenir de ma langue, que je ne manque pas de chérir dans ce qu'elle a de plus savant, de plus exhaustif, de plus accompli, mais aussi dans ce qu'elle a de plus vivant, dans sa capacité à opérer spontanément des mutations profondes et rapides, car je pressens bien que les "manières de dires" les plus informelles de notre époque seront enseignées demain ; elles auront été largement admises, puis largement acquises, elles auront, enfin, gagné leurs lettres de noblesse. Plus que tous les éléments précités en faveur d'une intervention "neutre" de l'écrivain public dans la question de la normalisation de l'expression francophone, il me semble que le refus viscéral de l'écrivain public de tout rôle figé, rigide qui, le rapprochant de la seule population des censeurs, au reste de plus en plus maigre, l'éloignerait de la population des hommes, seule sphère où sa fonction peut exister et s'épanouir, reste celui qui a sur moi l'impact le plus profond.
|