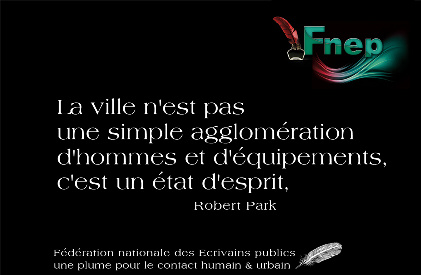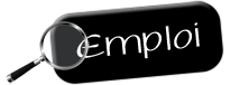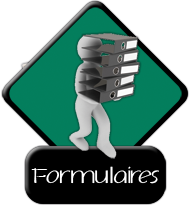Ecrivain public et environnement local
L'Ecrivain public et l'environnement localL'Ecrivain public se distingue par la connaissance qu'il a de son environnement et du terrain sur lequel il travaille. Il connaît les acteurs de la vie locale, avec lesquels il échange régulièrement, et ses spécificités. L'on fait appel à lui pour cette connaissance fine qui lui permettra d'orienter subtilement son usager, de saisir la particularité d'une situation qu'il n'est possible de comprendre qu'en pleine connaissance de tel ou tel impératif lié à la région, au quartier.Nouer des partenariats locaux qui contribuent à la circulation des informations relatives aux démarches courantes et à l'accès aux droits permet souvent de pallier un éparpillement des informations utiles à la vie administrative, juridique et courante. C'est également un apport en terme de service à la personne et d'enrichissement des compétences. Identifier les acteurs
|
Le travail de l'Ecrivain public se place dans une suite d'interventions globalement favorables au développement social local parce qu'elles s'appuient sur une citoyenneté active par laquelle les individus deviennent acteurs, s'appliquent à créer les conditions d’une véritable expression des habitants et générer des modes de coopération et de concertation entre habitants, élus locaux, institutions. La démarche individuelle de l'Ecrivain public s'oriente selon les axes du développement social local. Avec l'ensemble des responsables et acteurs du développement social local, il contribue à la lutte contre toute forme d’exclusion en aidant les hommes et les femmes à jouir de leurs droits et assumer leurs devoirs vis à vis de la société. Au niveau du territoire, le schéma de développement social local est défini selon un projet et après diagnostic. Quels sont les partenaires institutionnels et les collectivités locales intéressés au projet ? Quelles sont les valeurs qu'il renferme ? Les ressources locales qui vont venir l'appuyer ? Enfin quels sont les animateurs du projet de développement social local ? Les moyens mis en oeuvre ? Chaque Ville dispose d'un service ou chargé de Développement local, près duquel consulter le projet de développement social local. Coordonner ses actions
|
 L'Ecrivain public et ses différents
L'Ecrivain public et ses différents
partenaires : la notion de réseau
Parce qu'elle met en relation différentes parties autour de questions communes, la médiation sociale ne peut s'envisager qu'en tant qu'axe d'articulation de l'action de ses différents partenaires et des différents partenaires sociaux et institutionnels. C'est ce qui rend son action pérenne, met en exergue son caractère positif. C'est aussi ce qui lui permet de faire face à la diversité et à la complexité des situations auxquelles il est confrontées et pour lesquelles son intervention est requise : il a la capacité à coordonner son action par la connaissance qu'il a acquise de l'ensemble des partenaires susceptibles de la relayer.
Définir les réseaux formels et informels de l'intervention sociale,
propres à chaque territoire
La médiation n'est pas vouée à une recherche de solutions mais vise à permettre leur mise élaboration et leur mise en place par les différents intervenants spécialisés. Déployée sur le territoire national, les services et acteurs de l'intervention sociale attachés aux organismes formels (CCAS, CAF, Espaces départementaux...) sont formels et se retrouvent sur l'ensemble des territoires. Des dispositifs et des organismes spécifiques viennent les appuyer en local. Il est difficile de les référencer et de connaître leurs axes d'intervention a priori. Seule une connaissance solide du territoire, de ses spécificités, de ses structures, de ses axes de développement social et solidaire, de ses problématiques propres, permet de mettre en place une action efficace. Le livre blanc de la médiation sociale(4), publié par le réseau France Médiation, et l'article Médiation sociale : pour la reconnaissance d’un métier, chapitre définition et contours du métier p. 10-16, des, éditions du CIV(5), abordent plus en détail la nécessité, pour le médiateur, de s'inscrire dans la notion de réseau.
Il faut identifier le rôle plus ou moins reconnu de chacun, sa portée effective en terme de construction sociale du territoire, et permettre la résolution de situations individuelles par la pleine mise en oeuvre de l'ensemble des ressources collectives de ce territoire.
 Nous sommes bien dans une approche "réseau", parce qu'elle fait appel à des acteurs formels et informels et exige que chaque écrivain public dégage, sur son secteur géographique, des cadres partenariales. Il s'agit de construire une cohérence avec l'ensemble de ces acteurs en permettant une synchronisation d'interventions complémentaires.
Nous sommes bien dans une approche "réseau", parce qu'elle fait appel à des acteurs formels et informels et exige que chaque écrivain public dégage, sur son secteur géographique, des cadres partenariales. Il s'agit de construire une cohérence avec l'ensemble de ces acteurs en permettant une synchronisation d'interventions complémentaires.
Pour permettre cette coordination des différentes actions, il faut connaître précisément les intervenants, mais aussi leurs missions et la manière dont elle se déploie sur le territoire, les dispositifs auxquels elle fait appel. L'Ecrivain public est l'un des maillons de ce réseau, le rôle de médiateur qui est inhérent à sa fonction, n'est pas toujours reconnu car il reste émergent. Son cadre demeure relativement flou, d'autant plus qu'il ne suit pas de manière formelle son usager : celui-ci fait appel à lui librement et en fonction de ses besoins et problématique.
Le recours à l'Ecrivain public, totalement libre, le conforte dans son rôle de médiateur de l'écrit, qui n'intervient pour le compte de personne, mais "à la demande de...", et pour dégager un espace de discussion auquel chacune des parties peut adhérer, et dont chacune des parties peut se retirer à tout moment. Il ne vient pas défendre des intérêts, il défend le libre échange, ouvre une porte vers la résolution pacifique d'un conflit, d'un litige. L'émetteur comme le destinataire du courrier peut, à chaque instant, décider de rompre le dialogue qui s'est instauré par la correspondance, revenir sur ce qui avait été défini pour adopter une posture plus formelle qui consisterait, par exemple, à porter le litige en justice et opter pour une décision unilatérale et verticale (celle du juge). L'écrivain public doit donc affirmer sa position par rapport aux acteurs de la vie locale et sociale, ce qui n'est possible qu'en l'exerçant dans ses strictes limites.
(1)Le développement social local,nouvelle approche territorialisée de la cohésion sociale : préalables méthodologiques indispensables, Communication par Eric Pélisson, haut-fonctionnaire, ancien sous-préfet ville, enseignant à sciences po Paris et sciences po Lille - Centre d’Etudes de l’Emploi, Cnam, Profession Banlieue, Colloque Territoires, action sociale et emploi, 22 et 23 juin 2006 à Paris
(2) Définition sur la page Wikipédia consacrée au travailleur social
(3) Le défi du partenariat dans le travail social ou le paradoxe du partenariat obligatoire, par Élisabeth Vidalenc, chercheur en sociologie, site de l'Association des Directeurs de bibliothèques Départementales de Prêt
(4) Le livre blanc de la médiation sociale, publié par France Médiation (Réseau d'acteurs de la Médiation Sociale), pour faire suite aux dernières Assises nationales de la médiation sociale qui se sont déroulées les 12 et 13 décembre 2011 à Lyon
(5) Médiation sociale : pour la reconnaissance d’un métier, chapitre définition et contours du métier, p. 10-16, éditions du Comité interministériel des Villes (CIV), Cahiers pratiques hors série, décembre 2011