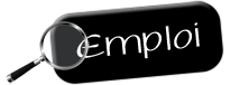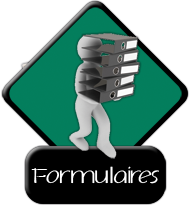Ecrivain public et posture de médiation
L'écrivain public et la posture de médiationL'écrivain public évolue dans un cadre flou. Souvent bénévole, salarié sous contrat aidé, il se voir affectée la fonction de médiateur (social, familial, culturel...), et l'exerce dans tous les cas de manière informelle. Il intervient comme tiers et dans une optique de médiation dans le cadre de la résolution des litiges, de l'accès à l'écrit, à l'outil informatique et à internet, et en tant qu'organe d'expression populaire. C'est pourquoi l'on adopte souvent le terme médiateur de l'écrit lorsque l'on évoque la fonction d'Ecrivain public.En pratique et si l'on s'en tient aux règles et à la déontologie de la fonction dégagée depuis l'apparition des premiers médiateurs sociaux, l'on s'aperçoit que de nombreuses pratiques sont similaires dans le cadre d'interventions de médiation et d'interventions de facilitation administrative ou d'écriture publique. Notamment la posture inaliénable de tiers, vis-à-vis des différentes parties en présence, se retrouve naturellement parmi les deux fonctions, comme l'obligation de confidentialité et le devoir de discrétion. L'apport des Femmes-Relais
| |||||||||
Le processus
|
Le processus
|
Le processus d'arbitrageL'arbitrage est un mode alternatif de résolution des conflits, dans lequel un arbitre intervient pour prendre des décisions qui engagent les deux parties qui font appel à ses services. C'est un mode non étatique de règlement des litiges. L'arbitrage intervient par l'intermédiaire d'un tribunal arbitral composé d'un ou plusieurs arbitres (en général trois). L'arbitre est un véritable juge dont la décision s'impose aux plaideurs. L'arbitrage permet donc de régler un litige (sans passer par les tribunaux de l'État mais par une juridiction arbitrale), en confiant le différend à un ou des particuliers choisis par les parties. |
Le processus de négociationLa négociation est la recherche d'un accord, centrée sur des intérêts matériels ou des enjeux quantifiables entre deux ou plusieurs interlocuteurs (on ne négocie pas avec soi-même, on délibère), dans un temps limité. Cette recherche d'accord implique la confrontation d'intérêts incompatibles sur divers points, que chaque interlocuteur va tenter de rendre compatibles par un jeu de concessions. La négociation peut aboutir à un échec ou à un accord. Une négociation qui se déroule en mode coopératif conduit en général à un accord dans lequel les deux parties s'estiment gagnantes (gagnant-gagnant). |
|
|||
La médiation...
...est un processus amiable et confidentiel de résolution des conflits. Il se distingue de la conciliation et de l'arbitrage (voir encadrés en bas de page).
Le rôle
du médiateur...
...consiste à gérer un conflit. Ce professionnel neutre, indépendant et impartial aide les protagonistes du conflit à trouver ensemble une réponse à la situation, jusqu’à la finalisation d’un accord mutuel.
Le médiateur
social...
...conçoit une médiation préventive par une veille dans les espaces publics et/ou ouverts au public. Il intervient sur les situations de dysfonctionnements en matière de biens et d’équipements publics. Il assure une mission de veille sociale et régule les conflits par le dialogue. Enfin, il intervient en interface entre les publics et les institutions.
La médiation sociale...
...Une définition a été adoptée en septembre 2000, lors du séminaire européen organisé par la DIV et la Communauté européenne. Elle est aujourd’hui reconnue par l’ensemble de la profession. « La médiation sociale est un processus de création et de réparation du lien social et de règlement des conflits de la vie quotidienne, dans lequel un tiers impartial et indépendant tente, à travers l’organisation d’échanges entre les personnes ou les institutions, de les aider à améliorer une relation ou de régler un conflit qui les oppose ».
Le rôle
du médiateur social...
...consiste à assurer une présence active de proximité, à gérer les conflits en temps réel ou sur un temps différé, à assurer une veille sociale territoriale, à mettre en relation avec des partenaires, à établir une concertation entre habitants et institutions, à assurer une veille technique, la facilitation et/ou la gestion de projets, la sensibilisation et/ou la formation, l'intermédiation culturelle.
La médiation institutionnelle...
...est un mode alternatif de résolution des litiges. Elle peut être mise en œuvre pour tenter d’éviter une action en justice et pour régler des litiges individuels entre les personnes physiques ou morales et les entreprises ou institutions. Gratuite, d’accès libre, elle intervient lorsque les autres recours internes sont épuisés.
Le médiateur institutionnel...
...est nommé par les pouvoirs publics. Il favorise le règlement de différends, de type juridico-techniques, entre administrés, usagers ou consommateurs, avec les institutions ou organisations.
L'Ombudsman...
...désigne dans de nombreux pays l'équivalent de la fonction de médiateur de la République, de Protecteur du citoyen (pays francophones), de défenseur du peuple, ou encore de défenseur du citoyen.
Principaux portails au service de la médiation
Tous ces médias numériques sont faits par des médiateurs, pour les médiateurs et les personnes intéressées par la fonction de médiation. Ils diffusent de nombreuses actualités autour des pratiques, de la reconnaissance du métiers, des formations et voies d'accès à la fonction.
Francemediation.fr
|
Wikimediation.org
|
Clubdesmediateurs.fr
|
Mediatoroscope.com
|