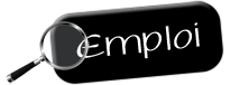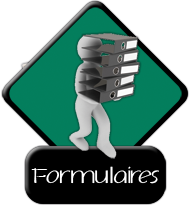L'écrivain public et ses financeurs
L'écrivain public et ses financeurs
 L'écrivain public se place en marge de l'institution, il ne peut en être l'auxiliaire que dans la même mesure, précisément, qu'il est auxiliaire de son usager. Sa posture est celle d'un tiers, indépendant et non-partie prenante. Un rôle indépendant d'autant plus difficile à assumer pour l'écrivain public, lorsqu'il a à conduire des actions portant sur des litiges usagers/institutions. Car dès lors qu'il n'est pas bénévole, il est le plus souvent amené à compter sur les financements publics pour assurer sa rémunération.
L'écrivain public se place en marge de l'institution, il ne peut en être l'auxiliaire que dans la même mesure, précisément, qu'il est auxiliaire de son usager. Sa posture est celle d'un tiers, indépendant et non-partie prenante. Un rôle indépendant d'autant plus difficile à assumer pour l'écrivain public, lorsqu'il a à conduire des actions portant sur des litiges usagers/institutions. Car dès lors qu'il n'est pas bénévole, il est le plus souvent amené à compter sur les financements publics pour assurer sa rémunération.
S'il n'est pas directement subventionné, il reste le plus souvent tributaire des enveloppes allouées à la vie sociale et locale. Le déploiement d'écrivains publics peut intervenir dans le cadre de marchés publics comportant des clauses sociales, dans le cadre du développement d'un service de médiation sociale par la collectivité, de co-fiancements dans le cadre des contrats aidés, des contrats CUCS ou du Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD).
Lorsqu'il n'est pas embauché par la collectivité, celle-ci participe, soit par versement direct soit par le prêt d'un local, de matériel informatique, à faire vivre l'écrivain public. Par ailleurs, préfectures et départements (conseils généraux) mettent souvent la main à la pâte. Pourtant, l'éthique de l'écrivain public lui impose de travailler en toute indépendance, particulièrement lorsqu'il a à conduire des actions de médiation entre usagers et institutionnels. Que faire, dès lors, lorsqu'un usager demande à son écrivain public d'écrire une lettre dans le cadre d'une procédure qu'il entame à l'encontre d'une décision émise par sa préfecture ? Lorsque la concertation habitants/institutions devient houleuse et qu'il est chargé de transcrire les souhaits de chaque partie, de faire remonter les attentes des uns, de transmettre les réponses des autres. Intervient-il alors en toute impartialité, impartialité qui doit être l'élément premier par lequel il se définit et se reconnaît ? En premier lieu, la profession doit s'attacher à dégager de manière formelle, contractuelle, une éthique et une déontologie propres à garantir son indépendance. En ce sens, les différents organismes professionnels ont adoptés des textes qui assurent tous la confidentialité, l'impartialité et la neutralité de l'écrivain public. En outre, la recherche de sources mixtes de rémunération doit permettre à la profession de s'affranchir progressivement des fonds publics dont elle dépend aujourd'hui trop largement, et de trouver des sources de rémunération complémentaires.
Une intervention "neutre" dans le cadre des intérêts individuels et collectifs
Les interventions de l'écrivain public social passent par une forme de médiation informelle, la médiation par l'écrit. L'écrivain public est un médiateur social informel et ponctuel. Son rôle de médiateur l'amène spontanément à adopter une éthique, une déontologie, des pratiques, obéissant à des principes propres à garantir son indépendance et sa neutralité, vis-à-vis de ses usagers comme des pouvoirs publics, quand bien même la pérennité de son emploi repose aujourd'hui quasi-intégralement sur des financements publics. Les médiateurs sociaux ont résolu la question en adoptant des principes déontologiques(1) qui les prémunissent contre toute forme d'instrumentalisation, et sur lesquels peut s'appuyer l'écrivain public. Ainsi, il exerce sa mission en toute indépendance vis-à-vis des protagonistes qu'il rencontre, et ne peut être investi d'aucun pouvoir de contrainte ni d'aucune autorité par une institution. Il intervient en toute discrétion et confidentialité. Les informations confiées par ses usagers à l'occasion d'entretien(s) ne doivent être communiquées ou divulguées qu'avec l'accord des personnes concernées. Les seules limites à cette obligation de discrétion et de confidentialité sont légales (obligation de porter assistance à personne en péril, obligation de dénoncer les crimes et les violences faites aux personnes particulièrement fragiles). Il applique également les principes déontologiques garantissant la qualité de médiateur, en adoptant notamment la posture de tiers impartial, qui lui permet d'intervenir auprès de ses interlocuteurs sans jamais s'y substituer ni jamais favoriser l'un ou l'autre. il intervient en toute neutralité. Le caractère neutre de cette intervention, lorsqu'elle s'applique aux intérêts individuels et collectifs, garantit la protection des deux parties en cas de litige entre usagers et administrations ou organismes.
Une limitation de la part de financements publics,
au profit d'un exercice libre et indépendant de la fonction
L'écrivain public est remis au goût du jour ! Le recours nécessaire à l'écrit dans le cadre de la vie courante, la multiplicité des démarches et la particularité de certaines situations, la rupture de certaines personnes avec l'écrit, l'outil informatique, ont permis à cette profession d'émerger de nouveau sous une forme nouvelle. Son apport positif quant à l'expression populaire, à la cohésion sociale et à la démocratie participative permettent une bonne perception de la fonction par la population. Paradoxalement, l'écrivain public "social" est souvent précaire, lorsqu'il n'est pas tout bonnement bénévole. Sa dépendance, vis-à-vis des fonds publics, est aujourd'hui l'un des aspects les plus problématiques de la fonction. D'une part, le déploiement d'écrivains publics ou de services d'écrivains public sur l'ensemble du territoires s'avère particulièrement coûteux, par ailleurs, la pérennisation même des postes les plus précaires (contrats aidés), est tout aussi délicate dans la mesure où la rémunération de ces contrats repose, elle aussi, quasi-exclusivement, sur des fonds publics. Il est donc fondamental, pour la professionnalisation et la reconnaissance de la fonction, de trouver d'autres ressources financières. La pratique de prestations payantes auprès du secteur privé, en marge d'une pratique sociale de la fonction, viendrait alléger la part des fonds publics intervenant dans la rémunération finale de l'écrivain public.
Vers la mise en place d'un référentiel d'activités et de prestations
 La reconnaissance progressive de la fonction par le grand public doit permettre, à terme, aux écrivains publics, de l'exercer pour partie à titre indépendant. La Fnep propose d'ailleurs un positionnement mixte qui permet à la fois, pour chaque écrivain public, de diversifier les sources de rémunération et de garantir le caractère mixte - social et indépendant - de la profession. Ainsi la partie de l'activité de l'écrivain public dédiée à des prestations sociales resterait rémunérée par les pouvoirs publics, et d'accès gratuit pour la population, tandis que la partie dédiée à des prestations à caractère littéraire serait payante pour l'usager. Autrement dit, dès lors que la prestations ne relèverait plus du champ social, administratif, ou de l'accompagnement à l'emploi, elle deviendrait payante. Un objectif inaccessible sans l'élaboration, par l'ensemble des écrivains publics, d'un référentiel exhaustif d'activités et de prestations faisant d'emblée la distinction entre les prestations purement sociales et vouées à rester gratuites pour les populations, et les prestations à caractère payant.
La reconnaissance progressive de la fonction par le grand public doit permettre, à terme, aux écrivains publics, de l'exercer pour partie à titre indépendant. La Fnep propose d'ailleurs un positionnement mixte qui permet à la fois, pour chaque écrivain public, de diversifier les sources de rémunération et de garantir le caractère mixte - social et indépendant - de la profession. Ainsi la partie de l'activité de l'écrivain public dédiée à des prestations sociales resterait rémunérée par les pouvoirs publics, et d'accès gratuit pour la population, tandis que la partie dédiée à des prestations à caractère littéraire serait payante pour l'usager. Autrement dit, dès lors que la prestations ne relèverait plus du champ social, administratif, ou de l'accompagnement à l'emploi, elle deviendrait payante. Un objectif inaccessible sans l'élaboration, par l'ensemble des écrivains publics, d'un référentiel exhaustif d'activités et de prestations faisant d'emblée la distinction entre les prestations purement sociales et vouées à rester gratuites pour les populations, et les prestations à caractère payant.
L'élaboration de ce référentiel est subordonnée à une contribution de l'ensemble des écrivains publics, c'est-à-dire des professionnels comme des bénévoles, des écrivains publics formels comme des écrivains publics informels, et implique donc la mise en place d'un réseau d'échange autour des pratiques de l'ensemble des acteurs de la fonction. Par la coopération qu'elle suppose, elle constitue donc un chantier ambitieux. En outre, ce référentiel doit-il distinguer les prestations d'écriture sociale, administrative, d'accompagnement aux démarches, des prestations d'écriture conseil, de correction, de relecture, de biographies ou de récits de vie, de l'animation d'ateliers d'écriture, des actions ponctuelles de promotion de l'écriture, de la lecture, de la langue française, etc., et donc intégrer un ensemble de sous-catégories qui doit être objectivement défini. Afin d'élaborer un référentiel le plus représentatif, la Fnep - Fédération nationale des écrivains publics, recherche des partenariats avec les différents syndicats, réseaux et associations. Ce référentiel distinguera les prestations selon leur catégorie (sociale : écriture administrative, accompagnement, médiation par l'écrit... littéraire : relecture, correction, réécriture, rédaction d'articles ou d'ouvrages à la commande), et permettra de distinguer les initiatives pour lesquelles des financements extérieurs s'avèrent incontournables des initiatives pouvant être exercées librement.
(1) Charte de référence de la médiation sociale d’octobre 2001 qui, avec les Principes déontologiques des femmes-relais des médiatrices sociales et culturelles, constitue le seul cadre déontologique reconnu par les pouvoirs publics en terme de médiation sociale.