Rapport pour la suppression du mot "race"
Droits de l'Homme
Rapport pour la suppression du mot "race"
Le mot "race" n'apparaîtra plus dans les textes législatifs. Une loi visant à le faire disparaître a été votée ce jeudi 17 mai 2013, à main levée, sur proposition du Front de Gauche. Nous vous donnons lecture de l'exposé du rapporteur, M. le Député Alfred Marie-Jeanne, enregistré à la Présidence de la République le 24 avril 2013. Il marque sans conteste un tournant dans la place accordée par la France à la diversité.
MESDAMES, MESSIEURS,
Le mot « race » a servi de fondement aux pires idéologies et, par ce biais, a conduit à la mort de millions de personnes. Il n’a pas sa place dans notre ordre juridique, même s’il est employé pour condamner toute discrimination fondée sur une prétendue « race ». Sa suppression ne fera évidemment pas disparaître le racisme. Elle ôtera cependant au discours raciste cette forme de légitimation qu’il peut tirer de la présence de ce mot dans notre législation. Employer le concept de « race », même si c’est pour prohiber les discriminations, n’est-ce en effet pas admettre, implicitement, son existence, alors qu’il est scientifiquement erroné ? Le code pénal peut-il fonder une incrimination sur « l’appartenance réelle ou supposée à une race » (ce qui implique qu’il pourrait y avoir une appartenance réelle à une « race ») sans valider le concept de « race » ?
La biologie et la génétique nous enseignent que l’espèce humaine est une. La langue du droit ne doit pas employer celle des préjugés, au motif douteux que seule cette dernière serait compréhensible par le citoyen. Les mots ont leur importance, leur poids symbolique, et « mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur de ce monde ».
Cette suppression a déjà proposé à de nombreuses reprises sous les deux précédentes législatures, par le groupe des député-e-s communistes et républicains et par le groupe socialiste. Chacune de ces initiatives a été repoussée par la majorité de l’époque, sous des prétextes divers, en affirmant chaque fois qu’elle partageait évidemment l’objectif, mais qu’il fallait attendre, créer un groupe de travail, étudier encore, que l’heure n’était pas venue…
Le président de la République ayant déclaré que le mot « race » n’avait pas sa place dans notre ordre juridique, et s’étant engagé à le supprimer de notre Constitution, le contexte de la présente proposition est heureusement fort différent aujourd’hui. Ne pas procéder à cette suppression serait en effet un reniement des prises de position adoptées hier, lorsque la majorité actuelle était dans l’opposition, reniement que rien ne pourrait justifier aujourd’hui.
La suppression du mot « race » de notre législation est motivée par la profonde ambiguïté juridique de ce terme, dénué de tout fondement scientifique et hérité de la législation de Vichy. Aucun des prétendus obstacles invoqués à l’encontre de cette suppression ne résiste à l’analyse.
I. – L’AMBIGUÏTÉ DU CONCEPT DE « RACE » EN DROIT FRANÇAIS
L’histoire du concept de race en droit français révèle la profonde ambiguïté du terme, puisqu’il servit de fondement à la fois aux discriminations racistes et, avant et après la Seconde guerre mondiale, à la législation antiraciste.
A. LA « RACE », FONDEMENT DES DISCRIMINATIONS RACISTES
Le concept de race sous-tendait déjà, implicitement, toute la législation coloniale. S’il n’apparaissait pas expressément dans le « code noir » élaboré par Colbert et promulgué en 1685, dont l’objet était de régler l’état et la qualité des esclaves dans les Antilles françaises et en Guyane, il y va de soi que l’esclave est noir. Dans la seconde version du « code noir », édictée en 1724, la composante raciale devient d’ailleurs plus explicite : les mots « esclave nègre » y sont employés, par opposition aux « blancs » mentionnés à plusieurs reprises.
Historiquement, le mot « race » est apparu, de manière expresse, dans la législation française en 1939, avec le décret-loi du 21 avril 1939, dit « décret Marchandeau », du nom du garde des Sceaux de l’époque. Ce texte avait pour objet d’interdire la propagande antisémite, dans un contexte de défense nationale, et réprimait la diffamation commise par voie de presse envers « un groupe de personnes appartenant, par leur origine, à une race ou à une religion déterminée ». Abrogé par le régime de Vichy, il fut remis en vigueur à la Libération, avant d’être remplacé par la loi n° 72-546 du 1er juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme.
C’est cependant sous Vichy, avec la législation antisémite, que la race est véritablement devenue une catégorie juridique en droit français. Ainsi, la loi du 3 octobre 1940 portant statut des Juifs dispose qu’est « regardé comme juif pour l’application de la présente loi toute personne issue de trois grands-parents de race juive ou de deux grands-parents de la même race, si son conjoint lui-même est juif ». La loi du 2 juin 1941 édicte par la suite une définition plus précise, en spécifiant qu’est « regardé comme étant de race juive le grand-parent ayant appartenu à la religion juive » et qu’est également regardé comme juif « celui ou celle qui appartient à la religion juive et qui est issu de deux grands-parents de race juive ».
B. LA « RACE », FONDEMENT DE LA LÉGISLATION ANTIRACISTE
Après 1945, le mot « race » n’est heureusement plus employé – à l’exception notable de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés – que pour prohiber les comportements racistes. En usant des termes « race » et « racial », même si c’est pour proscrire les discriminations fondées sur la « race », le constituant et le législateur n’entérinent-ils pas leur existence et ne leur confèrent-ils pas une objectivité ambiguë ?
1. Le préambule de la Constitution de 1946
Au lendemain de la Seconde guerre mondiale, le terme « race » fait son entrée dans notre norme suprême, la Constitution, mais cette fois-ci, en réaction à la barbarie nazie et au régime de Vichy, pour prohiber les discriminations raciales. C’est ainsi que la première phrase du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 affirme qu’« au lendemain de la victoire remportée par les peuples libres sur les régimes qui ont tenté d’asservir et de dégrader la personne humaine, le peuple français proclame à nouveau que tout être humain, sans distinction de race, de religion ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés ».
Il n’est cependant pas inutile de rappeler que les travaux préparatoires du Préambule de 1946 révèlent, de manière fort surprenante, voire troublante, qu’il fût introduit subrepticement et presque par erreur. En effet, c’est à la suite d’un amendement présenté par Paul Ramadier et adopté, lors de sa séance du 8 août 1946, par la commission de la Constitution de la seconde Assemblée nationale constituante, élue le 2 juin 1946, que le mot « race » fut inséré dans le préambule. Mais cet amendement était ainsi rédigé : « sans distinction de sexe, de religion ni de croyances ». Le terme race n’y figurait donc pas, et c’est après une suspension de séance, demandée par le président de la commission, André Philip, pour établir le texte résultant des travaux de la commission, que le mot « race » apparaît dans la première phrase du préambule, où il a remplacé le mot « sexe ». Cette insertion – et pour cause – n’a donc jamais été débattue. Elle n’a pas été davantage discutée lorsque le Préambule a été soumis à l’Assemblée nationale constituante, les 27 et 28 août 1946.
Relevons qu’il n’en fut pas de même lors de la première Assemblée nationale constituante, qui rejeta un amendement présenté par Jacques Soustelle, dont l’objet était d’interdire toute discrimination raciale ou religieuse. Gilbert Zaksas, le rapporteur général du projet de Constitution, s’y opposa au motif « qu’il n’y avait pas lieu, dans un texte comme la déclaration des droits, de consacrer la notion raciste qui était une arme entre les mains des fascistes et des nazis ».
Autrement dit, en 1946, l’insertion du mot « race », lorsqu’elle fut expressément présentée et donc discutée, fut repoussée pour les mêmes motifs que ceux avancés aujourd’hui pour obtenir sa suppression, et ce n’est que subrepticement, « par accroc », qu’elle fut insérée.
2. La Constitution du 4 octobre 1958
En 1958, cette condamnation des discriminations fondées sur la « race », la religion ou la croyance est reprise, tout d’abord, à travers la référence opérée au Préambule de 1946, qui conduira le Conseil constitutionnel, en 1971, à intégrer ce texte dans le « bloc de constitutionnalité ». Elle est réitérée, ensuite, à l’article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 – devenu l’article premier lors de la révision constitutionnelle du 4 août 1995 – dont la seconde phrase du premier alinéa proclame que la France « assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion ».
On observera qu’en 1958 également, le terme « race » semble avoir été introduit dans la Constitution sans débat. Ni l’avant-projet du 29 juillet 1958 présenté par le Gouvernement et soumis au comité consultatif constitutionnel, ni le texte du 21 août soumis au Conseil d’État, ni le projet préparé par le comité interministériel après l’avis du Conseil d’État du 28 août 1958 et soumis au Conseil des ministres, ne comporte la phrase mentionnant le mot « race ». Ce n’est qu’in extremis, lors de l’ultime étape, que cette phrase est ajoutée par le Conseil des ministres dans le projet soumis à référendum. Les travaux du conseil des ministres ne figurant pas parmi les documents relatifs à l’élaboration de la Constitution ayant été rendus publics, rien ne permet de savoir pour quelle raison cette adjonction a été opérée.
3. Les textes internationaux et européens
Au lendemain de la victoire contre le régime nazi, plusieurs textes internationaux, auxquels la France est partie, condamnèrent également toute discrimination fondée sur la « race ». La Charte des Nations unies du 26 juin 1945 fixe ainsi parmi les objectifs des Nations unies celui de développer et d’encourager le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinctions de race, de sexe, de langue ou de religion. La Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 proscrit également toute distinction fondée sur la « race ». Des références similaires à la « race » figurent dans les deux pactes internationaux de 1966 sur les droits civils et politiques et sur les droits économiques, sociaux et culturels, la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (art. 14), la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (art. 3) et dans la Convention internationale du 7 mars 1966 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale. S’agissant du deuxième de ces textes internationaux, la Déclaration universelle des droits de l’homme, il n’est pas inutile de souligner que dans la première version présentée par René Cassin, ne figurait aucune mention du mot « race ».
En droit de l’Union européenne, il est fréquemment fait référence à la race également, aussi bien dans le droit primaire (articles 10 et 19 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) que dans le droit dérivé.
L’emploi des mots « race » ou « racial » dans ces textes est cependant moins problématique que dans la législation française, dans la mesure où les textes internationaux et européens comportent un préambule, dans lequel il est généralement précisé que l’emploi de ce mot n’implique nullement la reconnaissance de l’existence de « races » humaines distinctes. Le sixième considérant de la directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique précise ainsi que « l’Union européenne rejette toutes théories tendant à déterminer l’existence de races humaines distinctes » et que « l’emploi du mot "race" dans la présente directive n’implique nullement l’acceptation de telles théories ». De même, le préambule de la Convention internationale de 1966 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale précise que « toute doctrine de supériorité fondée sur la différenciation entre les races est scientifiquement fausse, moralement condamnable et socialement injuste et dangereuse et que rien ne saurait justifier, où que ce soit, la discrimination raciale, ni en théorie ni en pratique ». La loi ne comportant pas de tels préambules, l’emploi des mots « race » ou « racial » y est bien plus problématique.
4. La législation française actuelle
Ces proclamations générales, constitutionnelles et internationales, ont été mises en œuvre et précisées par de nombreuses dispositions législatives et réglementaires, dans divers secteurs. Les plus nombreuses concernent la pénalisation des actes et des propos racistes. Des occurrences figurent cependant également dans des domaines aussi variés que le droit du travail, le droit de la construction ou celui de la fonction publique, par exemple.
Au total, dans notre droit actuel, le mot « race » ou ses dérivés « racial », « raciales », « raciale » et « raciaux » apparaissent dans la partie législative de 9 codes et dans 13 lois non codifiées. Au total, 59 articles sont concernés.
Les 9 codes concernés sont le code pénal (17 articles), le code de procédure pénale, le code du travail, le code du travail applicable à Mayotte, le code du sport, le code du patrimoine, le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, le code de la construction et de l’habitation et le code de la sécurité intérieure.
Les 13 lois non codifiées concernées sont :
– la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations (articles 1er et 2) ;
– la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (article 6) ;
– la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001 de finances rectificative pour 2001 (article 17) ;
– la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe (dite « loi Gayssot ») (articles 1er et 2)
– la loi n° 89-548 du 2 août 1989 relative aux conditions de séjour et d’entrée des étrangers en France (dite « loi Joxe ») (article 1er) ;
– la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 (article 1er) ;
– la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière (article 44) ;
– la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (article 15) ;
– la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires (dite « loi Le Pors ») (article 6) ;
– la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle (article 6) ;
– la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (article 8) ;
– la loi n° 50-772 du 30 juin 1950 fixant les conditions d’attribution des soldes et indemnités des fonctionnaires civils et militaires relevant du ministère de la France d’outre-mer, les conditions de recrutement, de mise en congé ou à la retraite de ces mêmes fonctionnaires (article 1er ) ;
– la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (articles 13-1, 24, 32, 33, 48 et 48-1).
C’est, bien évidemment, l’ensemble de ces textes, et non les seuls articles visés par la présente proposition de loi dans sa rédaction initiale, qu’il faut « toiletter », afin d’en supprimer le mot « race » et ses dérivés « racial » ou « raciaux » et d’y substituer, le cas échéant, le terme adéquat retenu.
II. – UNE SUPPRESSION DÉJÀ PROPOSÉE À PLUSIEURS REPRISES
La suppression du mot « race » de la Constitution ou de notre législation a été défendue dans l’enceinte du Parlement à plusieurs reprises :
– en novembre 2002, lors de l’examen du projet de loi constitutionnelle relatif à l’organisation décentralisée de la République, M. Victorin Lurel avait déposé un amendement tendant à supprimer le mot « race » à l’article 1er de la Constitution ;
– en décembre 2002, M. Michel Vaxès et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains avaient également déposé un amendement en ce sens, concernant, cette fois, l’article 132-76 du code pénal ;
– le 13 mars 2003, l’Assemblée nationale a discuté, en séance publique, la proposition de loi déposée par M. Michel Vaxès et les membres du groupe des député-e-s communistes et républicains tendant à supprimer le mot « race » de notre législation, à laquelle la présente proposition est quasiment identique ;
– en novembre 2004, M. Victorin Lurel et les membres du groupe socialiste et apparentés – parmi lesquels figuraient, notamment, le président de la République et le Premier ministre actuels, ainsi que la garde des Sceaux et le ministre de l’Intérieur – avaient déposé une proposition de loi constitutionnelle tendant à supprimer le mot « race » de l’article 1er de la Constitution et à mettre, en conséquence, le mot « origine » au pluriel dans ce même article ;
– en 2008, lors de l’examen du projet de loi constitutionnelle relatif à la modernisation des institutions de la Ve République, le groupe communiste et le groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche avaient déposé deux amendements visant à supprimer le mot « race » de l’article 1er de la Constitution et à mettre, en conséquence, le mot « origines » au pluriel. Soulignons que l’amendement du groupe SRC avait été défendu, dans l’hémicycle, par M. Jean-Jacques Urvoas, l’actuel président de la commission des Lois.
Chacune de ces initiatives a été repoussée par la majorité de l’époque au motif que, bien que partageant la philosophie et la finalité pédagogique d’une telle suppression, le mot « race » constituerait un instrument juridique indispensable à l’arsenal répressif antiraciste, afin d’assurer l’incrimination des infractions racistes.
Le 10 mars 2012, durant la campagne présidentielle, M. François Hollande a déclaré, lors d’un discours consacré aux outre-mer : « il n’y a pas de place dans la République pour la race. Et c’est pourquoi je demanderai au lendemain de la présidentielle au Parlement de supprimer le mot “race” de notre Constitution ». Cet engagement et le changement de majorité créent une conjoncture favorable, qui laisse légitimement espérer que la suppression du mot « race » de notre ordre juridique pourra, enfin, être opérée.
III. – DE FAUX OBSTACLES
Lors de la discussion des précédentes propositions de suppression du mot « race », précitées, cinq arguments principaux ont été invoqués par les opposants à cette suppression. Aucun de ces arguments – qui apparaissent comme autant de mauvais prétextes en faveur de l’immobilisme – ne résiste à l’analyse, dès lors qu’un substitut réellement satisfaisant au mot « race » a été trouvé.
A. L’EFFICACITÉ DE LA LUTTE ANTIRACISTE, EN PARTICULIER AU PLAN PÉNAL, N’EN SERA AUCUNEMENT DIMINUÉE
Le premier argument des opposants à la suppression du mot « race » est juridique : en se privant du mot « race » ou du mot « racial », l’arsenal répressif antiraciste perdrait son efficacité. Cette suppression risquerait de créer une lacune, un vide juridique, et le juge pénal ne pourrait plus condamner les comportements racistes actuellement incriminés.
Cet argument, s’il était fondé, serait un obstacle dirimant, car il n’est évidemment pas dans l’intention des auteurs de la présente proposition d’affaiblir, de quelque manière que ce soit et ne serait-ce que marginalement, la répression des comportements racistes, bien au contraire. Votre rapporteur l’a donc analysé de manière approfondie.
Il apparaît, au terme de cette analyse, que le risque de créer un vide juridique est inexistant, sous réserve de retenir un substitut aux termes « race », « racial » ou « raciaux » qui soit pleinement satisfaisant, c’est-à-dire juridiquement neutre. Cette conclusion se fonde sur deux arguments, dont seul le second est cependant véritablement décisif.
1. Les autres motifs de discrimination prévus par la législation pénale permettraient de condamner les comportements racistes
Il convient de souligner, en premier lieu, et même si ce n’est pas l’option privilégiée par votre rapporteur, qu’une suppression pure et simple, « sèche » (c’est-à-dire non compensée par l’insertion d’un autre terme s’y substituant) du mot « race » ou de l’un de ses dérivés « racial », « raciale » ou « raciaux », ne créerait qu’un risque marginal, pour ne pas dire infime, de créer un vide juridique en matière de répression du racisme.
En effet, la quasi-totalité des dispositions pénales employant le mot « race » ou ses dérivés, qu’elles prévoient une circonstance aggravante de certaines infractions d’atteinte aux personnes ou aux biens commises pour des motifs racistes ou qu’elles définissent une infraction, telles que les discriminations racistes, les crimes contre l’humanité ou les provocations, diffamations et injures racistes, accolent ce terme à ceux d’ethnie, de nation ou de religion. La formule la plus fréquemment employée est ainsi rédigée : « à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, réelle ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ». Dans ce cas de figure, le juge pénal dispose d’autres fondements textuels que le mot « race » pour condamner les comportements racistes. Il peut s’appuyer, selon les circonstances, sur l’ethnie, la nation ou la religion. Aucun de ces termes n’a une signification parfaitement identique à celle que les racistes confèrent au mot « race », mais la quasi-totalité, si ce n’est même la totalité, des comportements racistes pourraient être condamnés sur l’un ou l’autre de ces fondements.
Il reste cependant que, d’un point de vue théorique à tout le moins, il est concevable qu’un comportement raciste ne puisse être condamné sur le fondement de l’un ou l’autre de ces trois motifs. Par ailleurs, certaines dispositions législatives, très peu nombreuses, ne comportent pas les mots « origine », « ethnie », « nation », « religion » en sus des termes « race » ou « racial ». Il convient par conséquent, dans ce cas de figure, de trouver un substitut adapté.
2. Le mot « raciste » est un substitut garantissant que les comportements racistes actuellement incriminés le resteront de manière rigoureusement identique
Plusieurs substituts au mot « race » sont envisageables et ont été proposés au cours de la discussion des initiatives précitées. Il convient de souligner que le choix de ce substitut, du terme destiné à remplacer le mot « race » ou « racial » est déterminant. Juridiquement, il doit garantir que la suppression du mot « race » ou « racial » n’entraînera aucun recul pour la lutte antiraciste. Politiquement et symboliquement, il doit clairement signifier que la France rejette la notion de « race ».
a) Les mots « ethnie » ou « ethnique » ne sont pas des substituts satisfaisants
Une première option consisterait à remplacer le mot « race » ou « racial » par le mot « ethnie » ou « ethnique ». C’est celle retenue par l’article 3 de la présente proposition de loi. Votre rapporteur ne la considère pas satisfaisante. D’abord, parce que le terme n’a pas la même signification que le mot « race » et qu’il n’assurerait donc pas une parfaite identité de la répression antiraciste. L’ethnie désigne, selon le dictionnaire Larousse, un « groupement humain qui possède une structure familiale, économique et sociale homogène, et dont l’unité repose sur une communauté de langue, de culture et de conscience de groupe », tandis que la « race » est une « catégorie de classement de l’espèce humaine selon des critères morphologiques ou culturels, sans aucune base scientifique et dont l’emploi est au fondement des divers racismes et de leurs pratiques ». Il n’est pas inenvisageable qu’un discours ou un acte raciste, qui se fonderait, par exemple, exclusivement sur la couleur de la peau et sur elle seulement, sans aucune référence à d’autres éléments tels que la culture, la langue ou la conscience de groupe, ne puisse être considéré comme une discrimination ou une infraction commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance à une ethnie. Ensuite, parce que le terme « ethnie » apparaîtrait ainsi comme un euphémisme, une version « politiquement correcte » du mot « race ». Il ne s’agit pas de procéder à une euphémisation du mot « race », mais de lui ôter toute forme de légitimation.
b) « Origines » est un concept plus large que celui de « race »
Une deuxième option serait de substituer le mot « origine » ou « origines » au mot « race ». Cette option est plus séduisante que la première, car l’origine est un concept large, susceptible d’englober toutes les discriminations racistes. Cet avantage est aussi son inconvénient. Son champ étant plus large que celui du mot « race », cette substitution ne serait pas neutre juridiquement : elle pourrait conduire, dans certains cas, à une extension du champ de certaines infractions ou interdictions. Une discrimination fondée sur la « race » de la victime est plus circonscrite qu’une discrimination fondée sur l’origine de la victime, cette origine pouvant être sociale, géographique, etc. De plus, la condamnation expresse des discriminations fondées sur ce concept disparaîtrait en même temps que le mot.
c) Les termes « prétendue race » ou « supposée race » seraient juridiquement neutres mais brouilleraient sans doute le message politique
Une troisième option n’est pas une substitution, mais une réfutation. Elle consisterait à accoler l’épithète « prétendue » ou « supposée » chaque fois que le mot « race » est employé. Juridiquement, l’objectif de neutralité, de maintien de l’état du droit, serait atteint. Politiquement, le message serait cependant « brouillé » : on aurait « labouré la mer ». Par ailleurs, « l’appartenance ou la non-appartenance, réelle ou supposée, à une prétendue (ou supposée) race » serait une formule d’interprétation délicate par le juge.
d) La substitution du terme « raciste » à « racial » est l’option la plus satisfaisante
Une quatrième option consiste à remplacer le mot « race » ou « racial » par « raciste » ou par le membre de phrase « fondée sur des raisons racistes » ou « fondée sur un critère raciste ». Contrairement aux « races », le racisme, qui est la croyance erronée – et scandaleuse – en l’existence de « races » au sein de l’espèce humaine et d’une hiérarchisation entre elles, existe. La « haine raciale » devient ainsi la « haine raciste », une discrimination ou une infraction commise « à raison de l’appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée » devient « à raison de l’appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une religion déterminée ou pour des raisons racistes », les « persécutions en raison de leur race » deviennent des « persécutions racistes », les « déportés politiques et raciaux » deviennent les « déportés pour des raisons politiques ou racistes », etc. Cette substitution est juridiquement neutre. Politiquement, sa signification est simple et claire : les races n’existent pas, seul le racisme existe, et la France le rejette et le combat avec fermeté.
Votre rapporteur estime, pour l’ensemble de ces raisons, que ce substitut répond aux objectifs poursuivis. Le travail rédactionnel auquel il a procédé démontre que le mot « raciste » peut être substitué aux termes « race » ou « racial » dans 55 des 59 articles, précités, comportant ces mots. Les quatre exceptions sont les suivantes :
– l’article 8 de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, qui pose une interdiction de principe de collecte de données à caractère personnel faisant apparaître les « origines raciales ou ethniques », tout en y apportant de nombreuses exceptions (consentement exprès de l’intéressé, intérêt public, défense d’un droit en justice, recherches médicales, médecine préventive, INSEE, etc.) ;
– l’article 226-19 du code pénal qui reprend cette interdiction. Pour ces deux dispositions, une substitution comportant le mot « raciste » ne serait pas adaptée. Par conséquent, l’adverbe « prétendument » est accolé au mot « raciales », afin de montrer clairement que le concept d’« origines raciales » n’est en aucune manière jugé légitime par le législateur ;
– au 8° de l’article L. 2271-1 du code du travail, la substitution d’un membre de phrase comportant le mot « raciste » au mot « race » ne serait pas non plus adaptée. La modification adoptée consiste à prévoir que la commission nationale de la négociation collective est chargée de suivre l’application dans les conventions collectives du principe d’égalité de traitement entre les salariés, sans limiter la portée de ce principe aux distinctions fondées sur l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race ;
– il en va de même au 10° de l’article L. 133-2-1 du code du travail applicable à Mayotte, qui est modifié dans le même sens que le 8° de l’article L. 2271-1 du code du travail, précité.
L’argument des opposants à la suppression du mot « race » selon lequel ce terme serait indispensable à la lutte contre le racisme perd, avec un tel substitut, tout fondement.
B. LA SUPPRESSION DU MOT « RACE » EST PARFAITEMENT COMPATIBLE AVEC LE DROIT INTERNATIONAL ET EUROPÉEN
Le deuxième argument des opposants à la suppression du mot « race » est que ce mot subsistera dans de nombreux instruments internationaux et européens, précités, auxquels la France est partie. Tout comme le précédent, cet argument ne serait pas dénué de tout fondement si le mot « race » n’était pas remplacé par un terme adéquat. Il perd toute validité dès lors qu’un tel substitut a été trouvé.
En effet, il n’existe évidemment aucun risque d’incompatibilité du droit français avec le droit international et européen si l’on remplace le terme « race » par le mot « raciste ». Ni les conventions internationales, ni le droit de l’Union européenne n’imposent en effet que les États parties ou États membres adaptent leur législation ou transposent dans leur droit interne les actes adoptés en employant exactement les mêmes termes que ces instruments. Seul importe que le résultat fixé soit atteint. Une convention internationale ou une directive imposant de réprimer les actes ou les discours racistes est respectée de manière identique, que ces actes ou discours soient réprimés parce qu’ils sont « racistes » ou parce qu’ils ont été commis ou proférés « à raison de la race » de la victime.
Les conventions internationales et le droit de l’Union européenne ayant une autorité supérieure à celle des lois, même postérieures, en application de l’article 55 de la Constitution, et certaines de leurs dispositions étant directement applicables dans l’ordre juridique interne, le mot « race » subsistera dans le droit applicable par nos juridictions. Ce hiatus ne soulève cependant aucune difficulté juridique. Politiquement, il ne retire rien à la vertu pédagogique et à la signification politique de la suppression du mot « race » de notre législation, d’autant que ces instruments comportent généralement un préambule réfutant l’existence des « races » (voir supra).
Certains avancent qu’il faudrait attendre que le mot « race » soit supprimé des conventions internationales ou du droit de l’Union européenne pour procéder à cette suppression. Ils soulignent également que ce mot figure dans la Constitution et dans la législation de la plupart de nos partenaires. Pour eux, il est « urgent d’attendre ». Votre rapporteur estime, au contraire, que la France doit être volontariste. En ce domaine, elle ne doit pas hésiter à jour un rôle de pionnier. Si la France avait attendu, pour abolir la peine de mort, que tous les autres États l’aient eux-mêmes abolie, elle la pratiquerait encore. Dans le même sens, la France a-t-elle attendu que d’autres États fassent de même pour reconnaître, avec la loi nº 2001-434 du 21 mai 2001 (dite « loi Taubira »), les traites et les esclavages comme crime contre l’humanité ?
En supprimant le mot « race » de sa législation et en lui substituant le terme « raciste », la France démontrera qu’il est juridiquement possible de ne plus faire usage du mot « race », sans affaiblir en rien – au contraire – la lutte contre le racisme. Elle sera plus crédible et plus convaincante en ayant déjà procédé à cette réforme, lorsqu’elle mènera le combat pour la suppression du mot « race » dans les enceintes internationales et européennes. Votre rapporteur considère en effet que la France s’honorerait en œuvrant pour que ce mot, qui n’a pas davantage sa place en droit international ou européen que dans notre ordre juridique, ne figure plus dans les futures conventions internationales et actes de droit dérivé de l’Union européenne, dans un premier temps et, dans un second temps, pour qu’il soit supprimé des instruments internationaux et européens en vigueur.
C. L’HÉRITAGE DE 1946 SERA RESPECTÉ
Le troisième argument est que la suppression du mot « race » de notre ordre juridique impliquerait sa disparition du Préambule de 1946, qui fait partie de notre patrimoine constitutionnel et auquel il conviendrait de ne pas toucher. Votre rapporteur ne souscrit pas à cet argument, parce qu’il n’estime pas nécessaire de réviser le Préambule de 1946.
Contrairement à la Constitution de la Ve République, qui doit s’adapter aux évolutions de la société, le Préambule de la Constitution de 1946, même s’il fait partie de notre droit positif, est le reflet de principes affirmés à une date donnée. Il se fait l’écho du programme du Conseil national de la Résistance. Le retoucher serait un anachronisme, consistant à gommer, avec nos yeux d’aujourd’hui, ce qui avait paru utile au lendemain de la Seconde guerre mondiale (même si, comme cela a été souligné précédemment, l’inscription du mot « race » apparaît s’être produite dans des conditions surprenantes). Si l’on allait jusqu’au bout d’une telle logique, n’en viendrait-on pas à supprimer au nom de la laïcité, dans la Déclaration de 1789, la référence, à la fin de son préambule, aux « auspices de l’Être suprême » ?
La survivance du mot « race » dans le Préambule de 1946, alors qu’il serait supprimé de la Constitution et de notre législation, ne poserait aucune difficulté. Si le constituant décidait, en 2013 ou 2014, de supprimer le mot « race » de l’article premier de la Constitution, il ne ferait aucun doute qu’il entend proscrire l’emploi de ce concept dans la jurisprudence constitutionnelle et qu’il ne serait maintenu dans le Préambule de 1946 que comme un « vestige historique ». Plusieurs alinéas dudit Préambule sont d’ailleurs obsolètes et ont perdu, en réalité, toute force juridique. Il en va ainsi, par exemple, de l’alinéa 17, consacré à « l’Union française ». Nul n’a jamais proposé de réviser cet alinéa pour autant. Il a purement et simplement sombré dans l’oubli.
D. RIEN N’IMPOSE DE COMMENCER PAR RÉVISER LA CONSTITUTION PLUTÔT QUE LA LÉGISLATION
Le quatrième et dernier argument consiste à affirmer que le mot « race » devrait être supprimé de l’article premier de la Constitution de 1958, avant d’être supprimé de notre législation. C’est faire preuve d’un juridisme excessif. Il serait évidemment plus séduisant, pour les esprits kelséniens, de commencer par le sommet de la hiérarchie des normes. Juridiquement, rien n’impose cependant d’ôter le mot « race » de notre Constitution pour le supprimer de notre législation, surtout s’il est remplacé par le mot « raciste ». Notre législation continuera en effet de réprimer, dans les mêmes conditions qu’auparavant, les comportements racistes, et de répondre ainsi aux exigences de l’article premier. Les conditions ne paraissant pas réunies pour qu’une révision constitutionnelle supprimant le mot « race » aboutisse, il faut commencer par le supprimer de notre législation, sans reporter une énième fois à plus tard cette modification indispensable.
C’est pour l’ensemble de ces raisons qu’il convient de supprimer le mot « race » de notre législation, sans reporter une énième fois, pour de mauvais prétextes, une réforme de bon sens, tant attendue et humainement nécessaire.















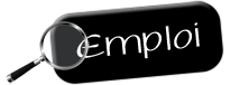













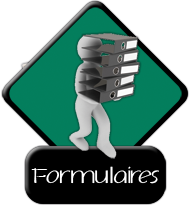










Ajouter un commentaire